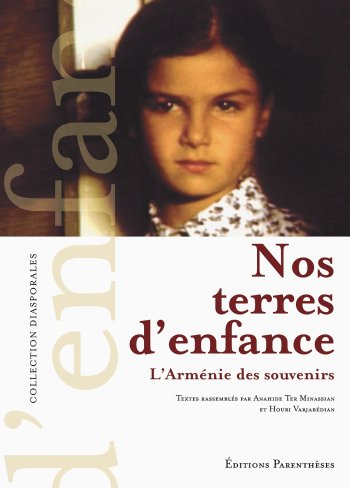Anahide Ter Minassian, Houri Varjabédian
Nos terres d’enfance
L’Arménie des souvenirs
Collection : Diasporales
Paru en août 2010
Prix : 25 €

Mélinée Manouchian
MANOUCHIAN
Témoignage suivi de poèmes, lettres et documents inédits
Collection : Diasporales
Paru en novembre 2023
Prix : 24 €

Meguerditch Margossian
Sur les rives du Tigre
Collection : Diasporales
Paru en mars 2022
Prix : 14 €

Chavarche Missakian
Face à l’innommable
avril 1915
Collection : Diasporales
Paru en avril 2015
Prix : 19 €

Fethiye Çetin
Le livre de ma grand-mère
Suivi de : Les fontaines de Havav
Collection : Diasporales
Paru en novembre 2013
Prix : 18 €

Jean-Claude Belfiore
Moi, Azil Kémal, j’ai tué des Arméniens
Carnets d’un officier de l’armée ottomane
Collection : Diasporales
Paru en avril 2013
Prix : 19 €

Takuhi Tovmasyan
Mémoires culinaires du Bosphore
Collection : Diasporales
Paru en octobre 2012
Prix : 22 €

Arménouhie Kévonian
Les noces noires de Gulizar
Collection : Diasporales
Paru en septembre 2005
Prix : 19 €

Avétis Aharonian
Sur le chemin de la liberté
Collection : Diasporales
Paru en novembre 2006
Prix : 14 €

Avis de recherche
Une anthologie de la poésie arménienne contemporaine
Collection : Diasporales
Paru en août 2006
Prix : 24 €

Michael J. Arlen
Embarquement pour l’Ararat
Collection : Diasporales
Paru en novembre 2005
Prix : 18 €

Jean Ayanian
Le Kemp, une enfance intra-muros
Collection : Diasporales
Paru en avril 2001
Prix : 19 €